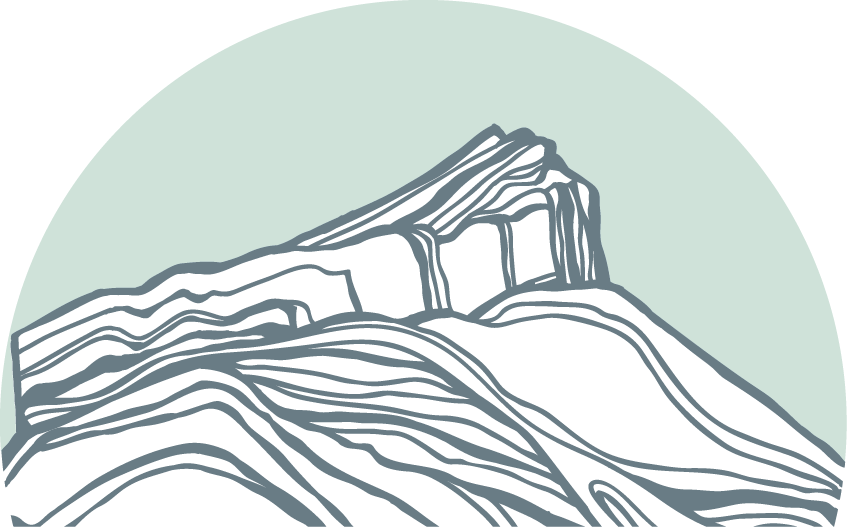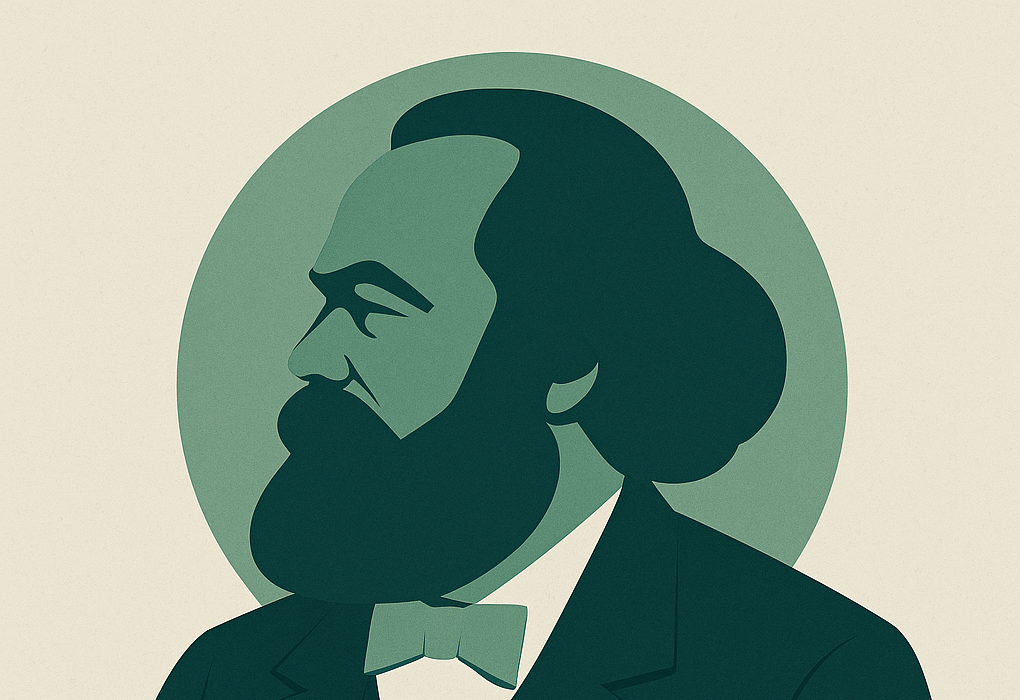Débuter un projet de création d’entreprise par l’écriture d’un « manifeste » peut probablement prêter à sourire. Pourtant, comme l’explique l’article sur l’orogenèse de Karst, c’est bien du manifeste que découle l’ensemble de Karst : son organisation, sa forme, son offre et sa manière d’intervenir dans les projets culturels. Pour nous, la rédaction de ce petit texte, finalisé en à peine une heure, fut ainsi l’acte fondateur de notre projet commun. Ce manifeste dit à la fois notre constat sur le secteur culturel, notre manière d’y prendre part, et ce que nous souhaitons y apporter.
Sans renier nos origines académiques, forcément très littéraires, nous l’avons structuré en trois parties et trois sous-parties dont nous vous proposons ici un rapide commentaire de texte.
Pour une culture responsable, inclusive et ouverte.
Responsable
Le secteur culturel en France n’est pas accessoire et pèse pour 2% du PIB. Il emploie autour de 700 000 personnes et émet 12 millions de tonnes de CO2 annuelles. Notre filière à une responsabilité de premier ordre face aux grands enjeux de notre décennie : réaliser la transition écologique, lutter contre le fascisme et bâtir une nouvelle forme d’organisation du travail émancipatrice et bienveillante.
. Respectueuse de l’environnement : accompagner les institutions vers une production culturelle écologique.
Il nous faut réemployer, ralentir le rythme des projets, voir y renoncer, et changer de paradigme, bien au-delà de l’adoption des « bonnes pratiques » individuelles.
. Respectueuse des usager-ères et des savoirs : rester intransigeant-e quant à la rigueur scientifique et la neutralité des approches.
L’ingérence politique permanente, la baisse du niveau scolaire, la propagation des fakes news et la marchandisation du secteur culturel fragilisent la parole des institutions culturelles, devenues locutrices parmi d’autres dans un débat où tout se vaut. Devant ce constat, il est plus que jamais nécessaire de défendre l’idée que le temps et la rigueur accordés au traitement d’un sujet sont les seuls gages de qualité de notre propos.
. Respectueuse de ses acteur-ices : travailler avant tout avec celles et ceux qui savent déjà faire, garantir un cadre de travail bienveillant et adapté aux besoins de chacun-e.
« Les métiers de la culture sont des métiers passion » : une idée qui a excusé à elle seule des décennies de mauvais traitement des employés du secteur culturel. Précarité, salaires indécents, management toxique, autoritaire ou absent, et surmenage systématique ont mené à la situation que nous connaissons aujourd’hui : la perte de sens et le mal-être au travail conduisent à une instabilité permanente des équipes mettant durablement à mal les institutions. Face à cela, il est impératif de construire des collectifs de travail stables et bienveillants qui permettent de préserver et développer les compétences de chacun-es.
Inclusive
Si la première partie de notre manifeste impose un constat et la volonté d’y répondre, la deuxième et la troisième partie décrivent notre manière de prendre part à ces nécessaires transitions.
« La France a reconnu l’accès à la culture comme droit humain inaliénable. Il est un préalable pour le respect de la dignité des personnes, dans leur diversité culturelle, pour leur inclusion sociale, scolaire et professionnelle. »
. Accessible : élaborer des médiations ambitieuses plutôt que des contenus simplistes.
Par manque de moyens et donc de temps, les institutions culturelles font de plus en plus le choix d’aborder des sujets très grand public, bankable, au détriment de sujets complexes qu’il est pourtant nécessaire de rendre accessibles au plus grand nombre. Nous pensons que tous les sujets peuvent, et doivent, être traités au sein de musées ou d’expositions et que la muséographie et la médiation ont justement pour objectif de rendre accessibles toutes les thématiques.
. Adaptée : étudier les publics avant toute démarche de production culturelle.
Les professionnel-les de la culture ont souvent « la tête dans le guidon », du fait du manque de personnel et du rythme d’expositions et de projets très soutenu. Il arrive souvent que les projets soient lancés et mis en place sans que personne ne s’interroge sur le-s public-s visé-s, le-s public-s déjà acquis, et celui ou ceux qu’ielles souhaitent toucher. Sans réaliser une étude des publics systématique, il nous semble essentiel de projeter des usages et des publics potentiels préalablement au lancement de toute production culturelle.
. Bienveillante : refuser tout cadre de travail ou contenu discriminant.
Le travail pour l’inclusion des minorités (de race, de genre, de classe) et des personnes en situation de handicap, à la fois comme professionnel-les de la culture, usager-ères et sujets est loin d’être achevé et notre secteur, compte tenu de ses caractéristiques socio-économiques se doit d’être particulièrement exemplaire.
Ouverte
. Participative : permettre aux institutions d’organiser et d’accueillir pleinement la participation des usager-ères.
Dans de nombreux pays, notamment anglophones ou en Suisse, les projets culturels sont souvent pensés avec les usager-ères. C’est une pratique encore rare en France : demander l’avis des publics implique de questionner son positionnement en tant qu’institution, et suppose parfois de repenser un sujet et beaucoup de nos pratiques professionnelles. Plus qu’à la démocratisation culturelle, nous croyons à la démocratie culturelle qui prend en compte toutes les cultures, qui n’est pas une culture descendante et élitiste.
. Pertinente : être constamment à l’écoute des enjeux, pratiques et modes du temps présent.
Beaucoup des dirigeants politiques et de leaders d’opinion voient à travers le secteur culturel (et particulièrement le champ du patrimoine) un moyen de diffuser des valeurs et de figer des traditions dépassées, à l’usage de leur projet politique. À l’inverse de cette idée dangereuse d’une culture hors du temps, nous affirmons que c’est en étant attentif-ve aux nouvelles pratiques, par l’inclusion de différentes communautés, l’ouverture et l’échange avec d’autres sociétés que nous pouvons créer une culture commune, pertinente, stimulante et émancipatrice.
. Créatrice de liens : mettre en lien et créer des synergies entre acteur-ices du territoire, usager-ères, et institutions pour faire émerger de nouvelles formes de productions culturelles.
La culture doit se faire avec et pour les publics. Elle doit aussi être pensée pour fabriquer des liens entre les acteur-ices du monde culturels, les associations et structures qui connaissent les usager-ères et les territoires, et les professionnel-les expert-es dans leurs domaines respectifs. Nous ne sommes ni une agence d’intérim, ni un cabinet de conseil hors-sol. Nous ne souhaitons pas faire à la place des professionnel-les, mais les appuyer lorsque le temps ou les compétences manquent, mettre à disposition notre réseau et permettre de créer des liens qui améliorent durablement l’ancrage des institutions et la qualité de leurs propositions culturelles.